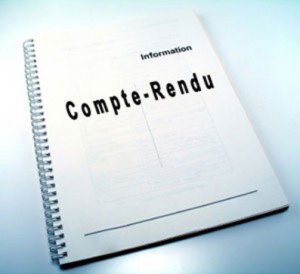
Compte-rendu du CNESERAAV du 4 décembre 2024
Le CNESERAAV du 4 décembre était présidé par le Directeur Général, l’Adjoint au Directeur Général et le Sous-Directeur de l’enseignement supérieur.
Nicolas Gilot, élu et Christine Heuzé, experte, représentaient FO Enseignement Agricole.
Le Directeur Général a souhaité faire une intervention au sujet du budget. Malgré le contexte (et le risque de motion de censure, confirmé en soirée), il est serein. Le budget a été établi en accord avec la ministre.
Dans les établissements, les budgets initiaux pour 2025 ont été votés par les Conseils d’Administration. La construction de la programmation budgétaire des établissements est le fruit d’un processus entamé en mars. Le programme de fin de gestion a été voté le 3 décembre et des moyens qui arriveront fin décembre et d’autres en janvier peuvent être déployés.
En 2024, la subvention pour charge de service public (SCSP) a été versée. 90% l’ont été en début d’année et 10% en fin d’année. Les 10% de moyens complémentaires ont été versés malgré le décret d’annulation de budget et le freinage des dépenses de l’Etat. Des moyens complémentaires ont même été versés à Oniris, à Bordeaux Science Agro, à AgroParis Tech et à l’Institut Agro Rennes-Angers, site de Rennes.
En fin de gestion 2024, la DGER a pu appuyer la prise en charge des coûts des Agents Contractuels sur Budget (ACB) pour les Centres Hospitaliers Universitaires Vétérinaires (CHUV). Un financement de l’ingénierie pour les bachelors agro a aussi été mis en œuvre.
En ce qui concerne le budget 2025, actuellement examiné par le Sénat, il est marqué par des réductions globales, mais la dotation des établissements est confortée. La baisse du Titre 2 (rémunération des agents payés par le ministère) n’entraînera ni réduction des salaires, ni suppression d’emplois. Les efforts de revalorisation se poursuivent avec des budgets alloués pour le RIPEC (Régime Indemnitaire pour les Enseignants-Chercheurs) et l’IFSE (Indemnité de fonctions, sujétions et expertise), ainsi que la prise en charge du GVT (Glissement Vieillesse Technicité).
Concernant le renforcement des ENV, l’ouverture des huit postes prévus a été pré-notifiée aux établissements. Ils seront ouverts.
La situation reste néanmoins contrastée : si AgroParis Tech est sur une trajectoire d’amélioration, d’autres écoles rencontrent encore des difficultés. Cependant, le Directeur Général a précisé que ce n’est pas la dotation de l’Etat qui génère les problèmes.
FOEA a fait une déclaration liminaire.
Le Directeur Général a répondu aux interventions des organisations syndicales.
Concernant les Ecoles Vétérinaires, les 8 emplois ont été générés en gestion. La volonté du ministère de diplômer 75% de vétérinaires de plus qu’en 2017 à l’horizon 2030 se prépare dès maintenant.
Les CHUV n’ont pas vocation à être rentables. Le choix a été fait de la préservation de l’ensemble des moyens. Nous voulons que 20% de plus de jeunes se forment dans nos écoles agro. La dotation sera en légère augmentation l’année prochaine. Pour 2025, le ministère va réduire d’autres budgets, celui de l’INRAE, par exemple. Il n’y aura pas de baisse de la trajectoire du CPER (Contrat de Plan Etat-Région).
Quant au projet de loi d’orientation agricole (PLOA), il pourrait être inscrit au Parlement dès janvier.
Pour le Bachelor, la DGER a versé une dotation pour l’ingénierie. Des groupes de travail ont eu lieu avec des directions, les consultations continuent et les inspecteurs de l’enseignement agricole poursuivent leur travail. Il y a eu des rendez-vous avec les OS. L’ouverture des 1ers bachelors se fera à la rentrée 2025. Une pré-dotation des écoles du supérieur sera versée.
FOEA a interrogé le Directeur Général : Quand les Bachelors seront –ils inscrits dans Parcours sup, quel type de formation, formation initiale ou par apprentissage ?
Le Directeur Général a répondu que les travaux continuent. Ce ne sera pas mis dans Parcoursup, c’est financé. Tout est fait pour que la mise en œuvre soit faite dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, il précise que répondre à appel à manifestation d’intérêt sur les compétences et les métiers d’avenir (AMI CMA, voir point 5) a permis de mobiliser 7 M€ pour défendre l’attractivité de nos écoles.
1 Approbation du PV de la séance du 11 juillet 2024 : demande de report.
2 Avis sur la répartition des moyens financiers et en personnels attribués en 2025 aux établissements d’enseignement supérieur
Contexte budgétaire :
Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025 prévoit une réduction du déficit public à 5,0 % du PIB, nécessitant un effort budgétaire total de 60 milliards d’euros. Le programme 142, consacré à l’enseignement supérieur agricole, contribue à cet effort avec une baisse de 11,5 millions d’euros, soit -2,6 % par rapport à la Loi de Finances Initiale (LFI) 2024.
Répartition des crédits :
- Dépenses de personnel (Titre 2) : Baisse de 2,6 %, avec une dotation de 179,5M€ contre 184,3M€ en 2024. Le plafond d’emplois reste stable à 2 800 ETPT.
- Autres dépenses (hors titre 2) : Réduction de 6,2M€ pour atteindre 170,4 M€, sans affecter les subventions pour charges de service public (SCSP).
- Budget total du programme 142 : 431,5M€, en baisse par rapport aux 443M€ de 2024.
Priorités stratégiques :
- Renforcement des Écoles Nationales Vétérinaires (ENV) : 8 nouveaux emplois créés pour 2025, portant la capacité d’accueil à 180 étudiants par école.
- Formation des vétérinaires et ingénieurs agronomes : Objectif d’augmenter de 75 % le nombre de vétérinaires et de 30 % le nombre d’ingénieurs formés d’ici 2030.
- Soutien à la recherche et à l’innovation : Maintien des dotations stables pour les activités de recherche.
Dotations spécifiques :
- Bourses sur critères sociaux : Baisse de 4 M€, ajustée en fonction de la sous-exécution budgétaire.
- Investissements : 18,4M€ dédiés aux projets liés aux contrats de plan État-Région (CPER) 2021-2027, incluant la rénovation énergétique et les normes de sécurité.
Réforme des primes des enseignants-chercheurs (RIPEC) :
- Augmentation des primes individuelles (C1) à 4 800 € en 2025 (+15 %).
- Maintien de l’enveloppe C2 à 1,8M€ et augmentation progressive de l’enveloppe C3 à 390 k€.
Selon la DGER, des efforts sont réalisés pour maintenir un équilibre entre rigueur budgétaire et renforcement de l’enseignement supérieur agricole, tout en priorisant l’augmentation des effectifs dans les filières clés.
FO s’interroge : tous les chiffres que vous nous communiquez sont en baisse. Vous expliquez que cela est lié à l’ajustement par rapport à la sous exécution structurelle du programme sur le titre 2. Mais dans les écoles, les collègues témoignent : ils manquent de tout. Ils sont par exemple obligés de diminuer les stages et les sorties sur le terrain. Dans le contexte d’augmentation du nombre d’élèves, il faut dédoubler les groupes et organiser plus de TD. Les locaux ne sont pas adaptés. Il manque de personnels.
Quant aux agents sur budget des établissements (ACB), nous constatons une baisse des plafonds d’emploi affectés aux établissements. Vous dites qu’il y a ajustement à la consommation réelle des établissements. En réalité, pour les établissements, il n’est pas possible d’employer et de rémunérer davantage d’agents. Les établissements n’ont pas les moyens de les payer, notamment dans le contexte des augmentations de salaires, liées à l’augmentation du SMIC et de l’obligation de prise en charge de la PSC. Les établissements nous disent qu’ils sont obligés de diminuer le nombre d’emplois pour augmenter les salaires. Le constat est que ces agents sont déjà moins bien rémunérés que les titulaires alors que leurs missions sont les mêmes. Sans ces personnels dans les services d’appui ou dans les CHUV, les écoles ne peuvent pas fonctionner. Quand les écoles suppriment ces emplois, il y a transfert des missions et des tâches sur les autres agents.
A FO, nous revendiquons « A travail égal, salaire égal ! »
FO alerte sur la précarité des personnels qui font la recherche, recrutés en post-doc ou en contrats à durée déterminée sur des projets peu pérennes. Comment envisager l’avenir des jeunes impliqués dans la recherche ? Quel impact sur la recherche dans nos établissements ?
| Vote | ||
| Pour | Abstentions | Contre |
| 6 | 4 | 26 (dont FO et toutes les OS) |
3 Arrêté modifiant l’arrêté du 9 janvier 2015 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat de paysagiste.
1- Contexte :
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) avant le 1er janvier 2019 le demeurent jusqu’au 1er janvier 2024 au plus tard (règle générale de révision des référentiels des diplômes tous les 5 ans).
Afin d’éviter l’exclusion du RNCP des certifications professionnelles non révisées d’ici le 1er janvier 2024, la ministre déléguée à l’enseignement et à la formation professionnels du précédent gouvernement a sollicité un report au 1er janvier 2025 de l’échéance de l’enregistrement des certifications professionnelles délivrées au nom de l’Etat afin que les ministères certificateurs concernés puissent achever les travaux de révision des certifications professionnelles qui n’ont pas encore été renouvelées.
Cette disposition impacte tout particulièrement le référentiel du diplôme d’Etat de paysagiste qui doit être révisé d’ici cette échéance.
Un dossier, comportant le projet de fiche RNCP, le référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation, ainsi qu’une note d’opportunité a été élaboré par un groupe de travail réunissant les quatre écoles habilitées à délivrer le diplôme d’Etat de paysagiste (l’École nationale supérieure de paysage, l’École de la nature et du paysage de Blois, l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux et l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille). Ce dossier, validé par le conseiller scientifique désigné par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au regard de sa conformité aux attendus de France Compétences, est soumis à l’avis du Comité de suivi des cycles licence, master et doctorat le 29 novembre 2024.
2- Présentation du projet d’arrêté modificatif :
A l’issue de ces travaux et de l’actualisation de la fiche RNCP pour le DEP, le projet d’arrêté remplace le référentiel de compétences de l’annexe de l’arrêté du 9 janvier 2015 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat de paysagiste.
Au cœur des enjeux du changement climatique, le paysage propose une méthode intégrative et démocratique pour accompagner les acteurs publics et privés face aux défis de la transition écologique des territoires. Ce référentiel décrit les missions et les compétences qui caractérisent le métier des Paysagistes concepteurs pour répondre à la multitude des problématiques et remettre le vivant au cœur des projets d’aménagements et de gestion des espaces publics, privés, et de planification spatiale des territoires urbains, ruraux et naturels.
| Vote | ||
| Pour | Abstentions | Contre |
| Unanimité | ||
4 Mission CGAAER sur les Violences sexuelles et sexistes
Les violences sexuelles et sexistes (VSS) touchent tous les secteurs d’activité de la société, y compris l’enseignement supérieur et ses usagers. Afin d’accompagner les établissements de l’enseignement supérieur agricole (ESA) dans la lutte contre les VSS, une mission CGAAER a établi un état des lieux de leurs plans d’action et proposé des pistes pour leur amélioration.
Retrouvez le rapport ici [https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/295410.pdf]
FO a déclaré :
Nous saluons le travail mené par la mission du CGAAER sur les violences sexuelles et sexistes (VSS). C’est un sujet longtemps occulté et passé sous silence dans nos établissements. Les récentes enquêtes montrent une augmentation du nombre de cas signalés, non parce que les comportements inappropriés se multiplient, mais parce qu’une prise de conscience s’installe : certains comportements et propositions sont inacceptables. La libération de la parole est un sujet majeur, tant pour les étudiants que pour les personnels, et les femmes ne se laissent plus faire.
Le rapport précise : « Des propos sexistes sont tenus surtout pendant les cours alors que les contacts non consentis, les agressions sexuelles et les viols se produisent d’abord pendant les événements associatifs sur site, puis au cours des soirées extérieures, dans les colocations ou les résidences étudiantes. »
Il constate aussi que « de nombreuses victimes, entre 12 % et 62 % selon la gravité des actes, ne parlent jamais de ce qu’elles ont subi. »
C’est dommage que la mise en œuvre des politiques de lutte contre les VSS repose souvent sur les seules convictions des équipes de direction. Certaines écoles, telles que l’ENSFEA ou l’ENSP, semblent peu impliquées, ce qui est d’autant plus dommageable que l’ENSFEA forme les futurs enseignants de l’enseignement agricole.
Dans les actions mises en œuvre par l’IARA, par exemple, nous avons trouvé intéressant que la restitution de l’enquête soit faite en mixant étudiants et personnels. Cela a rendu la parole plus libre. Cela est bénéfique aussi pour les personnels.
Pour obtenir des réponses significatives dans les enquêtes, il est indispensable d’instaurer un climat de confiance et de respect. La direction de l’établissement doit montrer son engagement à résoudre les situations.
Le partage des bonnes pratiques entre les écoles doit être favorisé. Souhaitons que le rapport de la mission y contribue.
Il est indispensable que les dispositifs de soutien soient mis en place et connus de tous.
Par ailleurs, tout étudiant ou personnel mis en cause doit bénéficier d’un entretien en présentiel et non en visioconférence. De plus, les modalités de cet entretien doivent lui être communiquées clairement et à l’avance. Les personnes de la cellule doivent être mesurées et trouver l’équilibre dans le retour aux personnes incriminées. Il est impératif que les membres des cellules d’écoute et d’accompagnement agissent avec mesure, garantissant un juste équilibre entre le soutien aux victimes et le respect des droits des personnes.
La sensibilisation, la formation et l’accompagnement sont les clés pour rassurer les victimes et combattre l’impunité. Chaque membre de la communauté éducative doit se sentir impliqué, écouté, soutenu et en sécurité.
5 Compétence métiers d’avenir.
L’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir » (AMI CMA) s’inscrit dans le cadre des objectifs et leviers de France 2030. Lancé en 2021 et doté initialement de 1,5 Md€, il vise à répondre aux besoins des entreprises et des institutions publiques en matière de formation, d’ingénierie de formation, initiale et continue, et d’attractivité des formations, pour permettre l’acquisition des compétences nécessaires aux métiers d’avenir de France 2030.
6 Questions diverses :
- FSU
1 -Audition au Sénat du 12/11 : site de Massy, avenir du Domaine de Grignon.
L’administration répond que le projet s’oriente vers une société universitaire locale immobilière (SULI).
On constate des avancées positives sur Massy. Il y a des discussions techniques mais pas de bocage politique.
2 -Transformation de poste des MC en IRPH (Ingénieurs de recherche Praticiens hospitaliers) ? Pour les ouvertures de postes d’enseignants-chercheurs, les conseils sont consultés dans les écoles.Ne devrait-il pas y avoir de consultation de ces instances pour la transformation des postes de MC en IR ?
Selon l’administration, les instances ne sont pas consultées pour les créations de poste d’IR, ou leur transformation.
3- Repyramidage :
L’administration répond que l’objectif de la DGER est bien de tendre vers le ratio 40% PR/60% MC ; l’équilibre doit se faire sur la globalité des établissements. Cela reste de la responsabilité du directeur s’il décide de rééquilibrer entre les écoles internes.
- Etudiants :
1 -Avenir du site de Grignon
2 –Où en est le rapport CGAAER portant sur la création d’une nouvelle école vétérinaire publique ? Quelle est la position de la DGER ?
L’administration répond que ce rapport a été remis au cabinet du ministre Fesnault, puis transmis à Annie Genevard qui a demandé sa publication. L’Adjoint au Directeur Général déclare qu’aucune création n’est prévue.
- FOEA :
1 -Autonomie des universités : le 19 novembre dernier, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a annoncé son souhait de « mettre en œuvre l’étape II de l’autonomie des universités ».
Cela aura-t-il un impact dans l’enseignement supérieur agricole ?
2 -PES : (prime d’enseignement supérieur). C’est la prime versée aux enseignants, PLPA ou PCEA affectés dans l’enseignement supérieur. Au CNESERAAV du 19 juillet 2023, une augmentation de cette prime était annoncée (la faisant passer de 2 308 € en 2023 à 2 785 €). Cela reste bien en deçà du C1 du RIPEC (4 200 €). Le CSA du MESR demande au ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche d’aligner le montant de la PES sur celui de la composante C1 du Ripec des enseignants-chercheurs. Que compte faire le MASAF pour améliorer la convergence ?
Nous rappelons que nous revendiquons l’intégration des différentes primes statutaires dans la rémunération indiciaire des agents.
L’administration répond que ces dispositions n’auront pas d’impact sur l’Enseignement supérieur agricole. La DGER se positionne contre les Responsabilités et Compétences Elargies (RCE) pour les établissements de l’ESA. Il faudra garder une certaine vigilance par rapport à cette simplification dans les partenariats sur les territoires.
Concernant la prime d’enseignement supérieur versée aux enseignants : le SRH reste vigilant à ce que les mesures mises en place au MESR soient étendues au MASAF.
Groupe de travail sur le rapport social unique (RSU) des établissements publics de l’enseignement supérieur agricole
C’est un travail qui est fait tous les 2 ans. Ce rapport, portant sur 2023, est issu de l’agrégation des informations transmises par les établissements publics de l’ESA. Il concerne les agents payés par le ministère et les agents payés par les établissements (ACB). Les premiers représentent les 2/3 des effectifs avec environ 3000 agents et les seconds 1/3 avec un peu plus de 1000 agents.
Les indicateurs sont les mêmes qu’en 2021. Dans la présentation, des comparaisons ont été faites avec le rapport de la fonction publique. Il n’y a pas d’informations sur l’action sociale.
